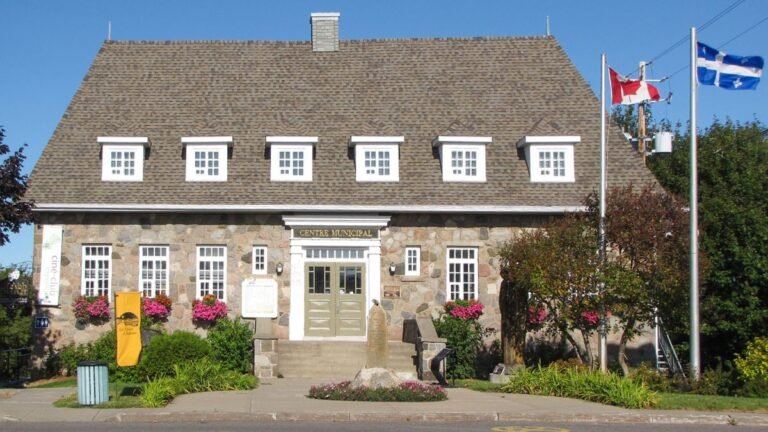Yann Fournis et Nathalie Lewis sont professeurs au Département de sociétés, territoires et développement de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR).
La démission de plusieurs élus municipaux a fait les manchettes récemment. Depuis les dernières élections municipales au Québec, en novembre 2021, plus de 70 maires ont dû être remplacés, dont la mairesse de Gatineau, France Bélisle, et la plus jeune d’entre elles, Isabelle Lessard, de Chapais. À cela s’ajoute le départ de plus de 700 élus municipaux.
Il est crucial de questionner les raisons de ces départs et de replacer le rôle des élus municipaux dans son contexte. On connaît peu de choses sur leur réalité. Pourtant, ils sont des acteurs incontournables sur les territoires du Québec.
Nathalie Lewis et moi sommes professeures à l’Université du Québec à Rimouski. Dans le cadre des recherches menées par le Groupe de recherche interdisciplinaire sur le développement régional de l’Est du Québec (GRIDEQ), nous avons récemment mené deux études qui examinent le rôle des élus dans la gouvernance municipale dans les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Matanie.
Ces études proposent des pistes de réflexion sur le métier d’élu et la crise actuelle de la démocratie municipale. Elles s’appuient sur deux enquêtes (auprès de respectivement 89 et 33 répondants) et des entretiens (auprès de 25 et 18 élus ou collaborateurs d’élus), qui ont permis d’appréhender les réalités des communes de la région.
Vents favorables et défavorables
Les élus municipaux sont de retour sur la scène territoriale depuis les années 1980, avec la création des municipalités régionales de comté (MRC) et l’adoption de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme en 1979 (récemment modifiée). Cependant, depuis 2015, leur position est devenue plus ambiguë.
Les maires sont en effet soumis à des facteurs à la fois favorables (décentralisation du pouvoir, politiques publiques favorables, etc.) et défavorables (mesures d’austérité, intimidations, démissions au sein des mairies, etc.). A cela s’ajoutent les réseaux sociaux, qui mettent désormais les élus municipaux sous une pression constante de critiques tous azimuts.
Un métier complexe
Les élus sont souvent considérés comme menacés ou fragilisés, pour des raisons multiples et classiques (manque de préparation initiale au métier d’élu, parité, conflits d’intérêts, participation citoyenne, etc.). C’est ce qui transparaît dans les travaux de la Fédération québécoise des municipalités qui, en 2017 et en 2024, a étudié les préoccupations des élus.
Ces enquêtes montrent que les situations problématiques ne sont pas rares (intimidations, vandalisme, exclusion). Elles sont aussi discrètes (peu formalisées, démultipliées par la proximité) et inégalitaires (au détriment des jeunes et des femmes).
Malgré les mesures récentes, le cadrage social et politique de ce problème reste complexe. Il est marqué par le flou du diagnostic, la pluralité des causalités et la difficulté d’identifier des solutions.
La complexité du métier d’élu local et la crise actuelle de la démocratie municipale nous obligent à élargir le questionnement afin d’appréhender l’ensemble des difficultés auxquelles sont confrontés les élus municipaux.
Pragmatisme et médiation
Pour considérer les élus comme des objets d’étude à part entière, il faut d’abord cesser de les ignorer. Les élus municipaux sont en effet fréquemment boudés par l’opinion publique, qui leur préfère d’autres acteurs locaux (acteurs communautaires, députés provinciaux ou fédéraux, etc.).
Cela est d’autant plus surprenant que les maires jouent un rôle essentiel dans leur commune, en œuvrant par exemple pour le bien de leurs concitoyens.
Les élus sont en effet les seuls à même de mener à bien la stratégie de leur collectivité territoriale par un usage approprié de l’institution municipale.
Une conclusion majeure de nos travaux est que le métier d’élu municipal au Québec repose sur la combinaison de deux mécanismes :
- Municipalisme pragmatique : Il s’agit d’un mécanisme politique et administratif de l’action municipale. Par son utilisation, le maire met en jeu sa crédibilité et ses compétences pour négocier avec ses partenaires locaux une vision dynamique des missions municipales. Assisté par l’administration municipale, le maire traduit ensuite cette vision en termes opérationnels afin d’aboutir à une définition appropriée de l’action municipale susceptible de recueillir l’adhésion de la collectivité.
- Médiation territoriale des collectivités : il s’agit d’un mécanisme sociologique et territorial de l’action municipale par lequel le maire mobilise sa connaissance fine de la collectivité pour l’incarner et la mobiliser de manière pertinente. Il peut ensuite déployer cette dernière à l’échelle intermunicipale dans des négociations autour d’un intérêt territorial plus large, incarné par la mission de la MRC et négocié avec les ministères provinciaux.
Isolé et mal soutenu
La combinaison de ces deux mécanismes permet de comprendre que toutes les dimensions du travail des élus municipaux au Québec sont soumises à des pressions importantes de la part du milieu ou des politiques publiques.
En tant que candidat, le futur élu est souvent mal informé, isolé et peu accompagné. En tant que décideur, le maire mène souvent seul l’action municipale, faute de soutien technique, technologique, psychologique ou administratif. En tant qu’acteur public, le maire doit constamment mener une conversation exigeante avec son administration et les autres acteurs collectifs municipaux ou régionaux. Enfin, en tant que leader associatif, les maires sont mal connus et connaissent de fortes tensions (conflits, intimidations, isolement).
Nos investigations concluent que c’est l’ensemble de ces dimensions qu’il faut prendre en compte pour résoudre la crise de la démocratie municipale, et pas seulement telle ou telle problématique. Des solutions existent — elles sont nombreuses — mais elles doivent couvrir l’ensemble des rôles remplis par les élus municipaux.
Une double loyauté
Le métier d’élu local apparaît donc à part. Il est en effet marqué par un double impératif, celui de la pertinence (pertinence) et celle de proximité.
Ces deux missions complexes comportent leurs propres enjeux. L’action municipale doit donc être pertinente (au sens où son pragmatisme conjugue légitimité politique et efficacité administrative) et offrir une représentation adéquate de la communauté (respectueuse des relations locales et des négociations territoriales entourant la MRC).
La complémentarité de ces missions dessine une définition plutôt inconfortable de la politique. L’élu se retrouve au cœur d’un jeu de double loyauté, puisqu’il peut être tenu pour responsable à la fois par la municipalité et par la communauté. Ce jeu de double loyauté oblige l’élu à mener une négociation délicate entre les figures antagonistes du maire entrepreneur municipal et du maire leader communautaire.
En tout cas, il s’agit moins d’un jeu à somme nulle que d’une multiplication :
- Chaque territoire offre une incarnation territoriale du Québec, selon une construction de bas en haut de la société québécoise.
- Chaque territoire construit une capacité collective d’action territoriale spécifique.
Le rôle principal du maire est, dans cette perspective, de mettre en œuvre une conception dynamique de son rôle d’« artisan » de la collectivité. Il active des mécanismes d’intégration du territoire québécois et construit une capacité d’action autonome.
Dans cette construction de collectivités territoriales au sein des 1100 municipalités du Québec, ce sont finalement les mille et un visages de la construction par le bas d’une société globale qui se jouent.
![]()