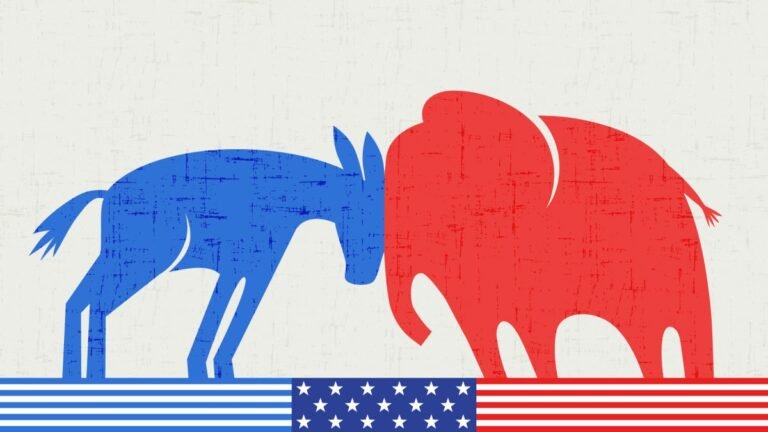L’auteur est chercheur associé à la Chaire Raoul-Dandurand, où ses travaux portent sur l’étude et l’analyse de la politique américaine.
Pour quiconque s’intéresse à la politique américaine depuis quelques années, il peut paraître normal, voire inévitable, que les élections soient serrées. Après tout, depuis le début du siècle, aucun candidat n’a remporté la Maison Blanche avec plus de 51 % des voix. À une exception près.
Et cette exception mérite d’être replacée dans son contexte : Barack Obama a été élu avec 53 % des voix en 2008, après l’effondrement de Wall Street qui s’est produit huit semaines avant l’élection. Le jour de la faillite de Lehman Brothers, le 15 septembre, Obama et son adversaire, John McCain, étaient au coude à coude.
Pourquoi y a-t-il une telle rivalité partisane, un tel suspense avant chaque élection aux États-Unis ? Est-ce seulement normal ? Historiquement parlant, la réponse est non.
Ce que nous avons vu depuis le début du siècle ne ressemble à rien de ce que nous avons vu depuis les décennies qui ont suivi la guerre civile américaine dans les années 1860.
Au cours des 25 dernières années, le suffrage universel et le collège électoral ont divergé à deux reprises (en 2000 et en 2016). Ils ont failli le faire une troisième fois en 2020, et pourraient le faire à nouveau en 2024.
Au cours des 25 années qui ont suivi la guerre de Sécession, le suffrage universel et le collège électoral ont également divergé à deux reprises (en 1876 et 1888). Et ils ont failli le faire une troisième fois en 1884. Il suffirait de 1 000 voix de plus à New York pour donner les clés de la Maison Blanche au républicain James G. Blaine, qui avait perdu de peu le suffrage universel.
Ces divergences se produisent lorsque l’élection nationale est extrêmement serrée. Dans le cas contraire, le Collège électoral a tendance à accorder une « prime » au vainqueur du suffrage universel, un peu comme le fait le système parlementaire canadien pour le parti vainqueur.
Ainsi, Richard Nixon en 1972 et Ronald Reagan en 1984 ont chacun pu remporter 98 % des États (49 sur 50) en remportant environ 60 % du suffrage universel.
Aujourd’hui, de tels scores seraient inimaginables pour l’un ou l’autre des deux principaux partis.
Et c’est le résultat direct des décisions stratégiques prises par ces mêmes partis depuis le début du siècle.
***
Voir l’ancien président Bill Clinton, l’un des plus grands orateurs que le pays ait jamais connu, s’adresser à la convention démocrate à Chicago la semaine dernière avec une fraction de sa vigueur d’antan et ses mains souvent tremblantes a été un autre rappel des ravages du temps.
Et c’est aussi un rappel de combien le Parti démocrate a changé depuis que Clinton a quitté la Maison Blanche en janvier 2001.
On dit souvent, et à juste titre, que Reagan aurait du mal à reconnaître le Parti républicain d’aujourd’hui. Il en va de même pour le Parti démocrate : dans sa forme actuelle, il n’accepterait jamais un leader qui aurait un programme comme celui proposé par Clinton lors de son entrée sur la scène nationale.
Bill Clinton avait adopté une approche dite de « triangulation », qui consistait à se placer à mi-chemin entre la base de gauche de son parti et l’opposition républicaine.
Alors qu’il a nommé deux juges « libéraux » (de gauche) à la Cour suprême, dont feu Ruth Bader Ginsberg, Clinton était résolument en faveur de la peine capitale et opposé à la légalisation de la marijuana. En revanche, il a signé des lois élargissant les soins de santé aux enfants ET limitant les programmes d’aide sociale aux adultes sans emploi. Il a également été le premier président depuis 40 ans à équilibrer le budget – et le dernier à le maintenir.
Il fallait pour cela un équilibre constant et un talent politique considérable, un talent dont Clinton était doté en réserve quasi inépuisable. Un talent qui, soit dit en passant, s’est révélé extrêmement profitable pour lui.
Les deux campagnes présidentielles de Clinton ont abouti aux plus grandes victoires démocrates, tant au niveau du vote populaire qu’au niveau du Collège électoral, depuis près de 200 ans, à l’exception de celle de Franklin Delano Roosevelt.
De tous les présidents interrogés par Gallup depuis Harry Truman, le taux d’approbation le plus élevé jamais mesuré pour un président en fin de mandat est de 66 %.
C’était Bill Clinton en 2001, alors qu’il quittait ses fonctions après l’élection de novembre 2000 entre George W. Bush et Al Gore.
***
Lors de cette fameuse élection, l’électorat n’était pas particulièrement polarisé au départ, les intentions de vote fluctuant considérablement au cours de la campagne. Mais quel résultat serré ! Gore l’emporta avec un demi-point de pourcentage de voix dans le vote populaire, Bush gagna le Collège électoral avec une marge de 271 voix contre 266, sur la base d’une avance de 537 voix en Floride.
Bush a commencé son premier mandat en tendant la main aux démocrates et en travaillant avec eux sur des réductions d’impôts et une réforme de l’éducation, entre autres. Puis sont arrivés les attentats du 11 septembre 2001, qui ont donné à Bush l’occasion d’être un président encore plus rassembleur. Ce qu’il a été, temporairement… jusqu’à ce qu’il prenne la décision controversée et source de divisions d’envahir l’Irak. Et il a gouverné – et fait campagne – selon une seule approche : motiver la base de son parti, même si cela signifiait perdre le centre.
Un pari gagnant : George W. Bush est devenu, en novembre 2004, le premier candidat de l’histoire à remporter une élection présidentielle tout en perdant le vote des électeurs indépendants.
Mais cela n’a pas été sans conséquences : la coalition électorale qui lui avait donné une nouvelle victoire serrée s’est rapidement désintégrée au cours de son second mandat.
Quoi qu’il en soit, la tendance était lancée. Après avoir vu un candidat du parti d’en face faire campagne et gouverner pour sa base, le Parti démocrate a compris qu’il pouvait faire la même chose. Et il avait faim.
En 2008, un nouveau sénateur démocrate, qui avait établi l’un des scores de vote les plus « à gauche » de sa jeune carrière au Sénat et qui avait fait campagne explicitement contre l’approche de triangulation de Bill Clinton, a conquis la base démocrate.
La « coalition Obama », si vantée depuis 2008, était en fait une version plus dynamique – et plus restreinte – de la coalition efficace que Clinton avait construite. Obama a attiré des électeurs plus jeunes et plus instruits, concentrés principalement dans les villes universitaires, issus de milieux urbains et de minorités ethniques. En bref, la majeure partie de la base démocrate, ainsi que des femmes célibataires. Toutes se sont déplacées pour voter pour lui en nombre record.
En 2012, face à un pays de plus en plus divisé et polarisé, la campagne de réélection de Barack Obama s’est directement calquée sur celle de Bush huit ans plus tôt : mobiliser la base démocrate, quitte à perdre le centre.
Et cela a fonctionné : Obama est devenu le deuxième candidat de l’histoire, après Bush, à remporter une élection présidentielle tout en perdant le vote des électeurs indépendants.
Mais, comme ce fut aussi le cas avec Bush, cette victoire reposait sur une coalition – ultra-concentrée dans les villes universitaires et les centres urbains – moins large que celle de Clinton, qui avait remporté à deux reprises des Etats plus ruraux comme le Kentucky, la Louisiane et le Tennessee, où Obama avait mordu la poussière.
***
La suite appartient à l’histoire : en 2016, en réaction à Obama, un candidat républicain est arrivé, qui n’a agi qu’en fonction de sa base. Et les démocrates, poussés entre autres par l’ascension de Bernie Sanders, ont adopté le programme le plus à gauche de leur histoire.
Malgré la promesse non tenue de Joe Biden en 2020 de « réunifier le pays », cette dynamique de division règne depuis.
Parce qu’une image vaut mille mots, voici la carte du Minnesota et de ses 87 comtés.

1992

2018
En bleu, à gauche, se trouvent les comtés remportés dans le Minnesota par Bill Clinton lors de sa première campagne présidentielle, en 1992. En bleu, à droite, se trouvent ceux remportés par Tim Walz, actuel candidat démocrate à la vice-présidence, lors de sa première campagne pour devenir gouverneur de cet État, en 2018.
Clinton a remporté le Minnesota avec la même marge que Walz (une douzaine de points) — mais il l’a fait avec une coalition géographiquement et culturellement plus large. Walz a été élu en maximisant son soutien dans les comtés qui comprenaient les Twin Cities (Minneapolis et St. Paul), où sa marge était de 20 points supérieure à celle de Clinton.
En 2022, Walz a été réélu avec quatre points d’avance et n’a remporté que 13 des 87 comtés. Dans d’autres États plus ruraux du Midwest, comme l’Iowa ou l’Ohio, il aurait été en grande difficulté.
À l’inverse, le Parti républicain n’a obtenu la majorité nationale dans le vote populaire qu’une seule fois — de justesse en 2004 — depuis 1988. Et il est presque impensable à ce stade que Donald Trump y parvienne cette année, tant sa coalition électorale est étroite.
***
La « nouvelle » campagne présidentielle de 2024 oppose un républicain aimé par la base du parti et détesté par le reste de l’électorat à un démocrate de San Francisco qui n’a jamais montré d’intérêt sérieux à travailler avec des élus du parti adverse.
Quoi qu’il arrive au cours des dix semaines restantes de la campagne, au moins deux choses semblent claires.
La première : l’issue du vote sera serrée.
Deuxièmement, quel que soit le vainqueur, il ne bénéficiera pas d’un « grand mandat populaire ». La base d’un parti aura simplement eu, encore une fois de justesse et de manière temporaire, le dessus sur la base de l’autre.