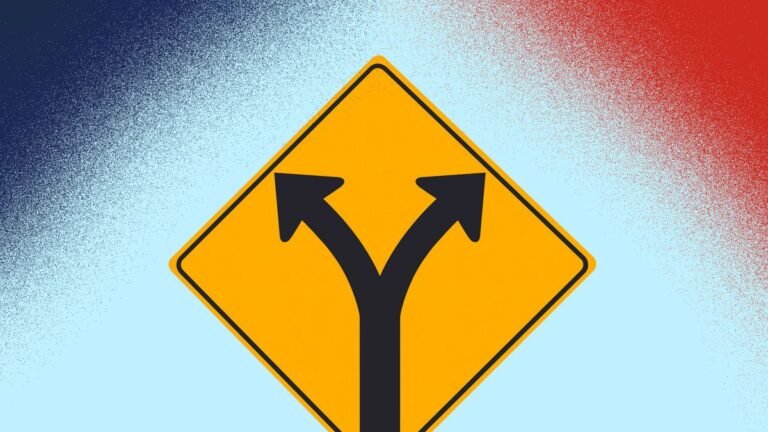La question nationale n’a plus l’effet d’épouvantail qu’elle produisait dans les années 1980 et 1990, au plus fort des crises constitutionnelles.
C’est le constat que l’on peut tirer des résultats du dernier sondage fédéral Léger, malgré le potentiel retour du débat référendaire sur l’indépendance du Québec. Après tout, le Parti québécois est en tête des intentions de vote au Québec et son chef Paul St-Pierre Plamondon a promis de tenir un référendum sur la souveraineté s’il arrive au pouvoir lors des prochaines élections générales québécoises, prévues en octobre 2026.
Et pourtant, avec moins de deux ans d’une telle probabilité, les électeurs canadiens et québécois ne ressentent plus ce qu’on pourrait appeler « l’angoisse de la séparation », comme ce fut le cas dans les années Trudeau, Lévesque, Mulroney. , Chrétien et Parizeau.
Certains chiffres de ce sondage Léger, tant à travers le pays qu’au Québec, m’ont même fait sourciller tant le portrait n’est plus le même. Explorons-les en détail.
Le Québec, « société distincte »
C’est le statut de « société distincte » inscrit dans l’Accord du lac Meech de 1987 qui a suscité les réactions les plus négatives et provoqué une crise constitutionnelle majeure trois ans plus tard. Cette affirmation selon laquelle le Québec n’est pas une province comme les autres en raison de sa culture, de sa langue, de son droit civil et de son mode de vie continue de diviser le Canada, trois décennies plus tard.
« Historiquement, les gouvernements du Québec ont demandé des aménagements spéciaux au gouvernement fédéral pour tenir compte de la culture et de la langue uniques de la province », peut-on lire dans le préambule d’une question du sondage. Viennent ensuite deux options de réponse : 1) Le Québec devrait être traité comme les autres provinces, ou 2) Le Québec mérite des aménagements spéciaux afin de protéger sa culture et sa langue.
L’appui au statut distinct du Québec demeure minime à l’extérieur du Québec : 71 % des répondants hors Québec s’y opposent. À titre de comparaison, un sondage Gallup de 1991 montrait que l’opposition du reste du Canada à ce statut juridique, un an après l’échec de l’Accord du lac Meech, variait entre 61 % et 82 %.
C’est au Québec que les chiffres sont les plus surprenants. Le consensus est moins clair qu’il ne l’était dans ce sondage Gallup de 1991, où ceux qui soutenaient la société distincte étaient trois fois plus nombreux que ceux qui s’y opposaient.
Dans le sondage Léger, à peine la moitié des répondants québécois (53 %) se disent favorables à des aménagements particuliers pour protéger la langue et la culture québécoises, comparativement à 38 % qui affirment que le Québec doit être mis sur un pied d’égalité avec les autres provinces.
Anxiété de séparation ? Ni au Québec ni dans le ROCHER
Avec le gouvernement caquiste en difficulté dans les sondages, la montée des appuis au Parti québécois et la forte possibilité que le gouvernement fédéral soit dirigé par le Parti conservateur de Pierre Poilievre l’an prochain, les Canadiens s’inquiètent du retour de la question nationale de Le Québec dans le récit politique du pays ?
Pour reprendre une courte réponse rendue célèbre par la citoyenne Raymonde Chagnon lors du débat des chefs aux élections québécoises de 2018 : pas tellement.
À la question : « Dans quelle mesure êtes-vous préoccupé par le fait que le Québec puisse un jour se séparer du Canada ? », 67 % des sondés à travers le pays se disent peu ou pas du tout préoccupés par cette possibilité, contre 26 % qui se disent très inquiets ou plutôt inquiets.
De toute évidence, le choix des mots dans une question d’enquête est crucial. « Concerné » (traduction libre de concerné) ici peut signifier différentes émotions chez différentes personnes. Cependant, les résultats de Léger hors Québec sont étonnamment similaires d’une province à l’autre. Le niveau d’inquiétude est légèrement plus élevé en Ontario (28 %) que dans l’ouest du pays (18 % en Colombie-Britannique et 22 % en Alberta).
Au Québec, le tiers des électeurs (32 %) se disent préoccupés par la possibilité d’une séparation du Québec. C’est une proportion beaucoup plus faible que celle qui s’oppose à la souveraineté du Québec (54 %, selon les plus récents chiffres québécois de Léger).
Ces chiffres semblent donc indiquer qu’au Québec comme dans le reste du Canada, une minorité d’électeurs ressentent une « angoisse de séparation ».
Le niveau d’inquiétude est plus élevé chez les jeunes électeurs (18-34 ans), où 36 % des répondants se disent inquiets d’une éventuelle séparation du Québec. Parmi les électeurs plus âgés (55 ans et plus), seuls 19 % avouent être préoccupés par la question. Cette différence est supérieure à la marge d’erreur estimée des sous-échantillons par groupe d’âge.
Il convient de noter que ces électeurs âgés de 55 ans et plus avaient plus de 25 ans au plus fort des débats constitutionnels dans les années 1990. Sans doute beaucoup s’en souviennent et, visiblement, ne sont pas perturbés par le retour de cette question.
La répartition des résultats selon le soutien aux partis fédéraux montre que ce sont les électeurs du Parti libéral du Canada qui se disent plus préoccupés par la question, mais toujours dans une proportion minoritaire : 37 % se disent préoccupés, contre 61 %. % qui sont peu ou pas du tout.
Parmi les électeurs du Parti conservateur du Canada, le niveau d’inquiétude est faible : 22 % inquiets, 75 % peu ou pas inquiets.
C’est chez les électeurs du Bloc québécois que l’inquiétude est la plus faible face à l’hypothétique séparation du Québec du Canada : 83 % sont peu ou pas inquiets.
Ces résultats peuvent être interprétés de plusieurs manières. Pour de nombreux Canadiens hors Québec, cette enquête pourrait paraître anachronique et hors contexte. Je couvre les sondages et les campagnes électorales partout au pays depuis près d’une décennie et je peux témoigner de nombreux échanges avec des électeurs du Canada anglais qui expriment leur surprise et leur étonnement lorsqu’ils voient mes graphiques montrant le Parti québécois en tête au Québec.
« Tout n’était-il pas réglé ? » » me disaient-ils souvent à propos des débats référendaires au Québec.
Certains diront que le Canada anglais est devenu indifférent à cette question. Cela fait certainement partie de l’équation, mais ces faibles niveaux d’inquiétude quant à l’unité canadienne pourraient aussi s’expliquer par le simple fait que le Canada n’a pas connu d’épisodes comme ceux des années 1980 et 1990 au cours du siècle actuel. Le PQ n’a pas obtenu de majorité à l’Assemblée nationale depuis 1998, alors qu’il était dirigé par Lucien Bouchard. Cela fait plus d’un quart de siècle sans « menace référendaire » concrète.
* * *
Vous trouverez le rapport complet de l’enquête Léger ici.