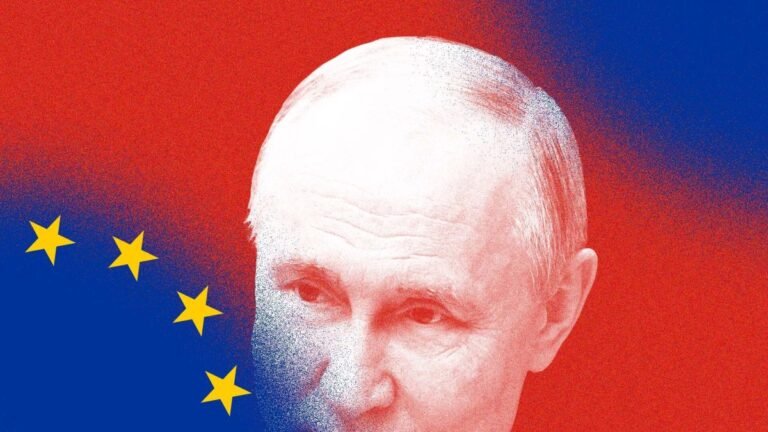L’auteur est un chercheur associé à la chaire Raoul-Dandurand, où son travail se concentre sur l’étude et l’analyse de la politique américaine.
Le vent virtuel panique qui souffle actuellement sur plusieurs capitales européennes importantes – que Paris, Londres ou Berlin – soit bien sûr causée par la position américaine dans le dossier ukrainien. La peur, comme nous le savons depuis le début du conflit, est que toute concession majeure faite par l’Ouest par les États-Unis à la Russie encouragera ce dernier à commettre de nouvelles attaques, à envahir d’autres pays européens, en commençant par ceux de l’ancien bloc soviétique, comme les Balts de Republics.
La peur devait être considérable pour que Vladimir Poutine soit considérable pour la Finlande et la Suède, deux pays dont la politique étrangère est définie depuis des décennies par neutralité, a mis fin à ce dernier en rejoignant respectivement l’OTAN en 2023 et 2024. Le Premier ministre du Danemark a résumé l’esprit actuel de plusieurs dirigeants de l’ancien continent en disant à la semaine dernière ce qu’elle aurait dit à son ministre de la Défense au sujet de l’offre militaire: “Acheter, achète, achète.”
L’inverse des États-Unis dans leur lutte contre la Russie en Ukraine est considéré par ces gouvernements comme la chute de leur meilleur rempart contre l’expansionnisme russe. Il va sans dire. L’annonce de la fin de l’aide militaire à l’Ukraine, faite par Donald Trump lundi, ne les aura pas rassurés, et le mot est faible.
Mais il y a plus que cela – beaucoup plus.
En tant que continent, l’Europe est marquée non pas depuis des décennies, mais pendant des siècles par une dynamique presque perpétuelle: la guerre. Il y avait les deux guerres mondiales dans le xxe siècle, bien sûr, qui provient du cœur même de l’Europe. Mais quelle était exactement la seconde moitié du siècle précédent le théâtre? La guerre de Crimée de 1853, la guerre austro-française de 1859, la guerre austro-prussienne de 1866, la guerre serbo-bulgarienne de 1885, pour n’en nommer que celles-ci – et c’est l’une des plus pacifique de l’histoire européenne. Avant cela, c’était les guerres napoléoniennes. Et avant …
La fin de la Seconde Guerre mondiale a marqué une rupture dans cette dynamique guerrière, en particulier en raison de la décision à long terme prise par les États-Unis pour assurer la sécurité de l’Europe. Contrairement aux mythes actuels, cette décision n’était pas motivée par une générosité de cœur, mais par un intérêt stratégique: face à la montée d’un nouveau monde bipolaire dans lequel seules deux grandes puissances allaient survivre à la guerre, les États-Unis ont voulu maximiser leur pouvoir face à l’autre (l’union soviétique) en prenant sous leur aile la plupart des pays européens.
À quelques exceptions très rares – notamment la dislocation de la Yougoslavie dans les années 1990 qui a conduit à la guerre des Balkans -, tout conflit potentiel entre différents intérêts européens est maintenant résolu par la diplomatie. Bien sûr, la création de l’Union européenne et l’interdépendance économique des différents pays peuvent être citées comme facteurs supplémentaires – le fait demeure que le rôle du parapluie géant que les États-Unis a été le tout premier ingrédient de la stabilité interne de l’Europe depuis 80 ans maintenant. Cette longue période a été définie non pas par la guerre, mais par la paix.
La dépendance des États européens au géant américain pour leur sécurité contre en particulier l’Empire russe signifiait également une possibilité de limiter les dépenses militaires … et d’offrir en retour à leurs populations (et donc à leurs électorats) un grand filet social. À partir du moment où les budgets militaires doivent être radicalement révisés vers le haut, ce sont des choix socialement – et politiquement – qui seront appelés à être faits.
Pour plusieurs dirigeants européens, en entendant Donald Trump annoncer un retrait américain d’Europe, qu’ils soient complets ou partiels, n’évoque ni plus ni moins le son de la couverture du pot.